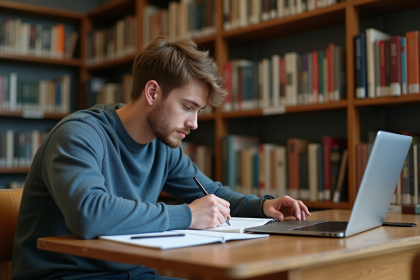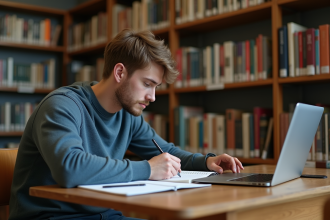Un arrêté ministériel de 2012 impose aux jonquiers d’intervenir sur des territoires dont la superficie dépasse parfois plusieurs centaines de kilomètres carrés, sans ressources humaines supplémentaires. Malgré leur rôle central dans l’application des réglementations environnementales, la reconnaissance officielle de la profession demeure partielle, notamment sur le plan statutaire.
Cette situation crée un écart entre l’étendue des missions confiées et les moyens réellement alloués. Chaque année, les effectifs stagnent alors que la pression sur les milieux naturels s’intensifie, conséquence directe des nouveaux usages du territoire et du changement climatique.
Agent de conservation de la faune : un métier au cœur de la préservation
Sur les rives du lac Saint-Jean ou au cœur des forêts du Saguenay, le gardien de la nature ne quitte jamais son poste. Sa mission, pourtant discrète, reste vitale : protéger la faune et la flore des parcs nationaux et réserves naturelles. Le quotidien du jonquier s’organise autour de la surveillance des espaces naturels, l’entretien des sentiers, et la sensibilisation constante des visiteurs. Impossible de s’installer dans la routine : chaque saison impose son lot de défis, la météo redistribue les priorités, et la vigilance envers les espèces menacées ne faiblit jamais.
Le métier change de visage selon le terrain. Gardien du littoral, il guette le moindre impact de l’activité humaine, intervient au plus vite en cas de pollution. Gardien de parc, il veille à la cohabitation entre promeneurs et nature, oriente les visiteurs, et fait respecter les règles. Tous, à leur manière, contribuent à la préservation de la biodiversité, que ce soit en France ou au Canada, du Saint-Laurent jusqu’aux rives du lac Saint-Jean.
Voici les missions qui rythment leur quotidien :
- Protection de la faune et de la flore locales
- Gestion et entretien des espaces naturels
- Sensibilisation du public aux enjeux écologiques
- Collaboration avec la police de l’environnement
Ces professionnels se distinguent par leur polyvalence. Appelés dès qu’une crise surgit : pollution accidentelle, braconnage, émergence d’espèces envahissantes. Leur présence rassure, leur expertise fait référence, leur implication inspire.
Quels sont les défis quotidiens et les missions d’un jonquier ?
Sur le terrain, le jonquier doit composer avec l’inattendu. Il parcourt les sentiers d’une réserve naturelle ou longe les rives d’un fleuve, carnet en main et regard attentif : traces d’animaux, indices du passage humain, changements dans la végétation. Les conditions météo imposent leur loi, les urgences environnementales aussi. Une mission débute rarement comme elle finit.
La sensibilisation du public façonne une large partie de ses journées. Accueillir les visiteurs sur le site, expliquer pourquoi certaines espèces sont menacées, répondre aux questions ou accompagner une classe sur un sentier : chaque échange compte. L’écoute et la pédagogie sont de mise, car la moindre discussion peut marquer durablement les esprits.
Sur le littoral, la pression des activités humaines se fait sentir à chaque instant. Le jonquier contrôle les accès, signale à la police de l’environnement toute infraction, note scrupuleusement la moindre entorse aux règles. Vigilance renforcée face au risque de pollution ou à l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes.
Les tâches principales se déclinent ainsi :
- Observation et protection de la faune et de la flore
- Entretien des chemins, balisage, contrôle des accès
- Éducation à l’environnement auprès des scolaires et des familles
- Collaboration avec les acteurs locaux pour préserver l’équilibre des écosystèmes
Le métier conjugue présence sur le terrain, médiation et rigueur scientifique. Impossible de parler de routine, chaque jour apporte son lot de défis, de rencontres, d’imprévus.
Pourquoi leur engagement est essentiel pour la biodiversité ?
Le métier de gardien de la nature se situe au cœur de la préservation de la biodiversité. Leur présence sur le terrain permet une veille attentive des écosystèmes : observation, suivi des espèces menacées, surveillance des effets des activités humaines. Sans cette vigilance de chaque instant, la détérioration des milieux naturels avancerait à pas feutrés, souvent sans retour possible.
Les gardiens échangent avec les institutions, travaillent avec la police de l’environnement, participent à la diffusion des droits de la nature et à la sensibilisation du public. Leur engagement fait émerger la question de l’écocide, notion juridique récente qui vise à sanctionner la destruction volontaire des milieux vivants. On pense, par exemple, à l’influence de Marine Calmet ou du collectif Or de question, mobilisés contre le projet industriel de la Montagne d’or en Guyane.
La reconnaissance du vivant s’incarne aussi dans le concept de symbiocène de Glenn Albrecht, qui invite à imaginer une harmonie retrouvée entre humains et nature, loin du modèle productiviste de l’anthropocène. Les communautés autochtones, alliées historiques des gardiens, portent cette vision. Leur combat pour la propriété collective des territoires et la défense des ressources naturelles inspire de nouveaux modes d’action collective.
Leur impact se mesure à plusieurs niveaux :
- Protection du vivant et des générations futures
- Transmission de connaissances et de pratiques écologiques
- Participation à l’évolution du droit en faveur de l’environnement
Être gardien de la nature, c’est tenir le front contre l’érosion du vivant, tout en restant en dialogue avec la société qui évolue autour.
Ressources et conseils pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre la profession
Le métier de jonquier, appelé aussi gardien de la nature, repose sur une bonne formation en environnement. Plusieurs chemins existent : cursus universitaire, BTS gestion et protection de la nature, licences professionnelles, masters spécialisés. Les centres de formation en France, mais aussi au Canada dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au parc national de la Jacques-Cartier ou sur la rive nord du Saint-Laurent, privilégient l’apprentissage sur le terrain, en lien direct avec la gestion des espaces naturels.
Acquérir une expérience concrète
Le passage sur le terrain fait toute la différence. Les stages et missions dans les parcs nationaux ou réserves naturelles permettent de toucher du doigt la réalité du métier. Collaborer avec des gestionnaires d’espaces naturels ou la police de l’environnement affine la compréhension des enjeux locaux, de la biodiversité aux réglementations.
Voici quelques pistes pour se lancer :
- Consultez les programmes de formation proposés par les établissements publics et universitaires spécialisés.
- Participez à des actions bénévoles ou à des chantiers nature pour découvrir le terrain sous un autre angle.
- Rejoignez des réseaux professionnels et associatifs, comme Wild Legal, qui forme juristes et citoyens à la défense des droits de la nature.
La Convention citoyenne pour le climat et les initiatives locales proposent aussi des espaces d’engagement. Misez sur la sensibilisation du public et l’éducation à l’environnement, deux axes majeurs du métier. L’accès à des postes de gestionnaire d’espaces naturels reste ouvert, surtout avec la montée des besoins de préservation.
Rester sur le qui-vive, garder la passion du vivant et refuser la résignation : c’est ainsi que le métier de jonquier conserve tout son sens, à l’heure où la nature réclame des alliés solides et déterminés.